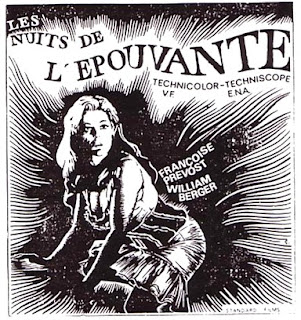Et Carreras se mit à la drogue.
Voilà un bien étrange film qui, s’il est loin d’être une merveille (très loin), possède quelques séquences dans sa seconde partie, absolument étonnantes, pour ne pas dire surprenantes.
Un bateau à vapeur transportant des explosifs (du Phosphore B qui explose au contact de l’eau) et quelques passagers de milieux différents, navigue dans la mer des Sargasses où il rencontre de monstrueux crabes, de curieuses algues et une société bâtie par les survivants du naufrage d'un navire Espagnol partit à la conquête du nouveau monde...
La première partie nous convie à une sorte de resucée sans argent des révoltés du Bounty. Maquettes de navire flottant dans une piscine pour les extérieurs, stéréotypies des personnalités, magouilles, trahisons, capitaine dur comme l’acier, chantage, parties de jambes en l’air et enfin révolte de l’équipage qui préfère quitter le navire à l’approche d’une tempête.
Ceux qui restent vont vivre une aventure qui dépaaaaaaaaasse l’imagination.
Poussés par la tempête, ils échouent sur l’île des Sargasses où ils découvrent non seulement une secte aux mains d’un enfant et d’une sorte d’inquisiteur fou (pléonasme) mais aussi et surtout un délire visuel dû à l’abus de psychotropes ou à l’univers d’Egard Rice Burrugoughs sous acides.
Attaqués par des algues carnivores (ben quoi ?) dont la mer est remplie, les descendants des survivants espagnols se déplacent avec de grosses raquettes aux pieds (pour ne pas se faire becqueter) et munis de deux gros ballons que l’on imagine gonflés à l’hélium (pour ne pas s’enfoncer dans l’eau). C’est assez ridicule certes, mais d’une part c’est follement cocasse, de deux c’est du jamais vu au cinéma et de trois c’est quand même pas con comme invention !
Sur ce continent on croise aussi des mollusques vilains, des scorpions en caoutchouc et un « homme-octopode » (à défaut de lui trouver un nom).
Quoi qu’il en soit et contre toute attente, la dernière demi-heure est très plaisante à suivre, le réalisateur et ses acolytes arrivant à créer un vrai climat poisseux et glauque, notamment lors des séquences se déroulant à l’intérieur du galion échoué.
Si l’on n’échappera pas à un happy-end bien dans la tradition, le clou du spectacle restera le sort réservé aux prisonniers de l’inquisition. Jetés dans la bouche d’un monstre souterrain qui ressemble à un vagin denté (Freud, si tu nous entends…) et qui ressemble étrangement au monstre situé dans le désert de Sarlacc de «Le retour du Jedi». Monsieur Lucas, ce n’est pas beau de copier !
Chroniques d'ici ou d'ailleurs :
https://www.psychovision.net/films/critiques/fiche/1149-peuple-des-abimes-le
https://www.lefilmetaitpresqueparfait.fr/2020/04/le-peuple-des-abimes-1968.html