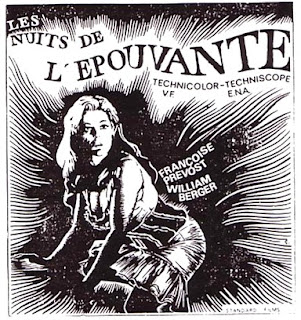Rubber Killer
Aujourd’hui, nous vous invitons à Suivre l’odyssée singulière d’un pneu psychopathe et télépathe.
Tel Ulysse au prise avec les dieux de l’Olympe, Rubber vous mettra en contact avec la rébellion pneumatique. Trouvera-t-il sa Pénélope ?
Etes-vous prêt à mettre la gomme et à regarder un slasher avec un pneu dans le rôle du méchant ?
Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent aux aventures d'un pneu tueur et télépathe, mystérieusement attiré par une jolie jeune fille. Une enquête commence.
Amis, amies humains, l’heure est grave ! La colère gronde chez les masses laborieuses pneumatiques ! Le caoutchouc en a gros sur la gomme !
Marre d’être considéré comme la dernière roue du carrosse de la civilisation de la bagnole.
Pneu vous chaut, alliez-vous dire ?
Pourtant, réfléchissons-y un instant...
On s’apercevra vite à quel point la vie d’un pneu peut s’apparenter à un croisement entre l’esclavagisme et la torture.
A peine né, on le fait s’accoupler à une roue ou à une jante (et parfois les deux !). On lui introduit une valve par son orifice afin de lui balancer de l’air ou de l’azote. Ballonné, humilié, accouplé contre son gré, il va devoir avaler des kilomètres de bitume avec sur le dos un poids immense.
Par respect pour le lecteur, nous ne parlerons pas, ni des crevaisons, ni de l’horrible supplice moyenâgeux que constitue le rechapage.
Une fois vieux, usé jusqu’à sa fibre primordiale, on le jette, le balance dans une décharge ou pire on le brûle avec des centaines de ses congénères. De ces immenses autodafés émergent (à qui sait les entendre) les cris d’agonies pneumatiques où se mêlent souffrances, humiliations et appels à la vengeance. Dans le désert, personne ne va entendre un pneu crier, se lever et défier le monde des humains. C’est l’histoire de Rubber, le pneu meurtrier télépathe.
Voilà un long-métrage qui, par les temps qui courent, ne devrait même pas avoir le droit d’être fait. A des billions de kilomètres des modes, il dynamite autant les conventions que Goldorak explosaient la tronche des Golgoths venus prendre d’assaut la terre. Si l’on n’y verra pas de lasero-lames, ni de corno-fulgures, on y verra un pneu en long plan-séquence parcourir le désert afin d’assouvir la vengeance des siens.
On peut d’ailleurs se poser des questions sur la santé mentale du réalisateur qui ose nous pondre une histoire aussi branque, surtout qu’il n’en est pas à son premier essai si l’on se réfère à son précédent opus «Steak», considéré par beaucoup comme une merde intangible, mais par certains comme un film culte au charme tout particulier.
Bref, du cinoche singulier, à destination d’un petit groupe de personnes qui attendent autre chose qu’un énième remake poussiéreux ou qu’une comédie sentimentalo-branchouille.
Robert ( donnons ce nom à notre pneu ) écrase des insectes, Rubber explose des têtes, Rubber prend une douche, Rubber regarde la télé, Rubber n’a pas de rapports sexuels, mais il aimerait sans doute cela. Son activité trépidante (n’est-il pas ?) est scrutée à la jumelle par un groupe d’humains au milieu de nulle part, dont on ne sait rien, dont on ne sait pas pourquoi ils font cela et qui ravagés par la faim se verront offrir un met empoisonné afin de mettre fin à cette intrigue. Pourquoi ? Aucune raison.
Aucune raison de faire ce film, aucune raison de le regarder, aucune raison à l’univers, aucune raison tout court. C’est le charme de Rubber.
Nonsensique dans l’acception anglo-saxonne du terme, on se croirait devant une bafouille des monty pythons. Un peu comme ce sketch où une race de yaourts extra-terrestres transformaient les anglais en écossais afin de gagner le tournoi de tennis de Wimbledon, Rubber n’a aucun sens en soi.
Nanti de quelques dialogues savoureux pour qui aime le énième degré, d’acteurs étonnants desquels émergent la trogne de Wings Hauser, bien loin de son rôle dans... «les feux de l’amour» ! (série horrifique pour mamies sédentaires).
On pourra néanmoins noter une longueur un peu trop importante du métrage, qui aurait donc gagné à être plus resserré (mais alors ce serait un moyen-métrage, impossible à sortir en salle) qui amène le réalisateur à multiplier quelques séquences qui se ressemblent. Mais aussi, une introduction peu utile dans sa volonté d’expliquer ce qui, justement, n’a pas besoin de l’être.
Un dernier mot pour dire que Rubber ne plaira pas à tout le monde, il n’en a ni l’envie, ni la prétention. Non pas que ceux qui ne l’aimeront pas soit des gens méprisables, loin s’en faut, mais il fait partie de ces films qui ne ciblent pas un public large comme tant d’autres. On l’aimera ou le détestera, mais on aura du mal à le trouver moyen ou banal.
Rubber n’est pas en toc, ni en plastoc, ce n’est pas du cinéma caoutchouteux, mais du cinéma singulier, unique et un vrai plaisir pour cinéphage à la recherche de «l’ofniesque» sur pellicule.
NB : Rubber n’a aucun sens, comme cette chronique
On ne saurait trop que conseillé la vision du court-métrage «Non-film» disponible dans l’édition collector . Mise en abîme improbable du tournage d’un film. Nonsensique jusqu’au bout des ongles.
Chroniques d'ici ou d'ailleurs :