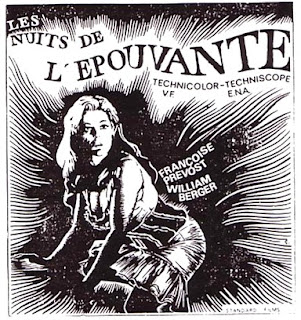Nami/Sasori
est enfermée à perpétuité dans une prison pour femmes. Pour lui
avoir crevé un œil, le gardien en chef a fait de son cas une
affaire personnelle. Sa résistance aux humiliations des gardiens lui
vaut le surnom de Scorpion. Après avoir été une fois de plus
maltraitée, Matsu s'échappe avec six autres détenues lors d'un
transfert. Le gardien en chef lance la traque, la cavale commence...
Le
meilleur de la série et le meilleur de l’exploitation. Plus de 35
ans après sa sortie, « elle s’appelait Scorpion »
peut revendiquer son droit au statut de film culte par un formidable
mélange de trouvailles visuelles et d’engagement féministe. Un
film qui hante longtemps après sa vision.
Retour
à la case départ pour Nami/Sasori/Scorpion, un an s’est écoulé
depuis le précèdent chapitre et sa vengeance envers celui qui l’a
trahie, un an passé au fond d’un cachot humide et sombre afin de
lui enlever son venin. Mais le scorpion ne meurt pas si facilement et
il est toujours prêt à piquer à la vitesse de l’éclair.
DU
WIP AU ROAD-MOVIE
Tourné
la même année que « La Femme Scorpion », ce second opus
d’une série qui en comptera jusqu’à neuf ( six de 1972 à 1977
puis trois de 1991 à 1998, seuls les quatre premiers étant
interprétés par Meiko Kaji ), n’est en rien une vulgaire
séquelle. Cette suit va plus loin, plus fort en radicalisant son
discours, poussant plus loin son féminisme anarchisant.
La
partie intrinsèquement WIP ( acronyme de « Women in Prison »,
connu aussi sous le nom de « Women in Cage ») est
rapidement expédiée pour s’orienter vers un road-movie à forte
influence « Western-spaghetti » tout en restant fermement
inscrit dans le folklore nippon, donnant ainsi à l’ensemble une
touche totalement singulière.
La
visite d’un ministre dans le pénitencier de femmes permet à
Sasori de sortir de son cachot, affaiblie, mais toujours dangereuse.
Quand le scorpion, animal résistant à beaucoup de choses ( même
aux armes nucléaires dit-on) frappera le directeur des lieux, la
punition sera terrible. Alors que les autres détenues seront
contraints de charrier d’énormes blocs de pierres, Nami sera,
quant à elle, violée par une poignée de nervis afin de rendre
caduque son statut de meneuse et d’héroïne en l’humiliant de la
pire des façons ( une scène particulièrement épouvante
d’ailleurs)
Si
la sanction semble porter ses fruits sur la majorité de ses
codétenues, elle n’entame en rien la volonté insécable de
Sasori, opposée à toutes formes de procrastination dès lors qu’il
s’agit de profiter de la moindre occasion de se faire la belle. Ce
qui adviendra bien vite suit au rapatriement en fourgon de la
carrière de pierre au pénitencier, Nami permettant une évasion
collective de sept des prisonnières.
Dès
lors le film prendra vraiment son envol en s’orientant résolument
vers un des plus formidables road-movie du cinéma, mêlant
adroitement fantastique, aventure, cohésion, traîtrise, sentiments,
horreur, études de caractères et surtout charges au vitriol de la
société japonaise.
APPORT
DU CINEMA EUROPEEN DE GENRE
Ce
qui frappe à la vision de ce long métrage, c’est le syncrétisme
entre apports européens de cinéastes majeurs du genre (Mario Bava
et Sergio Léone en particulier) et culture folklorique nippone
traditionnelles. Le réalisateur puise à plusieurs sources sans
toutefois jamais faire preuve de plagiat pour l’insérer dans un
discours reflétant sa vision de la société insulaire de son époque
( rien d’étonnant d’ailleurs qu’un Quentin Tarantino se soit
abreuver à cette source tant son univers se rapproche de celui de
cette série).
La
cavale de ce groupe de femmes dans un décor dépouillé et
désertique renvoie inévitablement au western-spaghetti, de même
les plans larges sur la lande austère, les gros plans sur les
visages ,les long manteaux des évadées, le mutisme de l’héroïne,
les ralentis, «Léonisent » le trait à l’envie.
La
part opératique des éclairages, des couleurs et de la photographie
quant à eux, font échos avec le travail opéré dans le gothique
italien d’un Bava ou d’un Argento ( une cascade se transformant
en geyser de sang, un plan qui se déchire façon «fumetti »,
d’autres travaillés dans tous les sens façon « Le masque du
Démon » ou « La fille qui en savait trop » ).
Mais
Shunya Ito n’est pas qu’un vulgaire copieur et s’il s’appuie
sur une culture cinématographique cosmopolite et un sens de la
technique solide, il insère ces emprunts à la tradition théâtrale
notamment. Les actrices ( à l’exception de Sasori/Scorpion
évidemment) en fond des tonnes, surjouent presque, notamment celle
qui symbolise l’hostilité des femmes envers Scorpion et dont le
jeu renverrait presque au théâtre Kabuki par son emphase et ses
grimaces.
De
même l’insertion dans une histoire qui à priori ne le permet pas
d’un dose de fantastique onirique (« Kwaidan » and co)
qui irrigue le Kabuki permet non seulement à l’intrigue de ne pas
s’essouffler en offrant une forme de pause à l’action, mais
développe aussi et surtout l’idée de la quête quasi-christique
de la belle Sasori dans au moins trois séquences surréalistes d’une
beauté qui laissent pantois ( Le conte chanté des crimes des sept
évadées autour d’un feu de camp, le « passage de témoin »
entre la vieille femme et Scorpion léguant un couteau semblant
« chargé »de toute la haine ancestrales du sexe dit
faible et le passage dans un tunnel permettant une digression sur la
«vraie» personnalité des prisonnières. Somptueux !)
INSOUMISSION
ET FEMINISME DANS LA SOCIETE JAPONAISE
Ce
qui n’aurait pu être qu’une bonne série B dopée à
l’esthétisme et à la perversion masculine, acquiert ses lettres
de noblesses grâce à la radicalité de son propos, donnant par
ricochet une vision peu complaisante de la société nipponne et de
la place de la femme dans celle-ci . Une charge impitoyable contre le
machisme le plus haïssable, un pamphlet féministe et une
vitupérante critique sociale où la violence nihiliste semble régner
en maître. Stéréotypant ( du moins on l’espère !) l’homme
dans ses plus vils instincts, « Elle s’appelait Scorpion»
les présente comme des êtres méprisants, malfaisants et uniquement
inféodés à leurs pulsions, se servant de la femme comme d’un
objet. Passe encore pour les geôliers dont le rôle est par essence
éminemment coercitif, mais même l’homme de la rue n’est pas
mieux loti ( en témoigne ce car de touristes qui après avoir vanté
le bon vieux temps de la guerre sino-japonaise, abuseront jusqu’au
meurtre d’une des prisonnières).
Si
le réalisateur nous offre en écho le souvenir de cette guerre,
c’est pour mieux « métaphoriser » celle que livre les
évadées symbolisant celle de toutes les femmes contre l’ordre
établi de l’homme. Sasori imposé en tant que figure christique et
portant le fardeau de la violence séculaire faite aux femmes, à
elle de les guider vers la liberté au prix d’un farouche combat (
Dans un troublant final, Sasori suivi de ses comparses traverseront
un pont tel Moïse et ses disciples traversaient la Mer vers la terre
promise).
S’appuyant
de manière évidente dans le creuset et les derniers soubresauts de
1968 ( qui au Japon fut contestataire et revendicatif) et une
actualité où à l’instar de certains pays européens, l’extrême
gauche japonaise multipliée les attentats, Shunya Ito propose un
film plein de bruit, de haine et de fureur. Sur la situation des
femmes et des minorités, Ito hurle son dégoût. Un cri puissant qui
résonne encore trente-cinq ans plus tard.
Violent,
baroque, nihiliste, féministe, n’oubliant pourtant jamais qu’il
est un film d’exploitation, « Elle s’appelait Scorpion »
ne peut décemment laisser indifférent.
Un
petit chef d’œuvre.
Chronique d'ici ou d'ailleurs :
https://www.psychovision.net/films/critiques/fiche/986-elle-sappelait-scorpion
https://www.devildead.com/review/614/elle-s-appelait-scorpion-joshuu-sasori-dai-41-zakkyo-bo